
Erlab renforce sa capacité de production. Erlab accroît sa capacité de fabrication grâce à…
erlab-marketing30 janvier 2024
 Actus
Actus ActusEnvironnement
ActusEnvironnement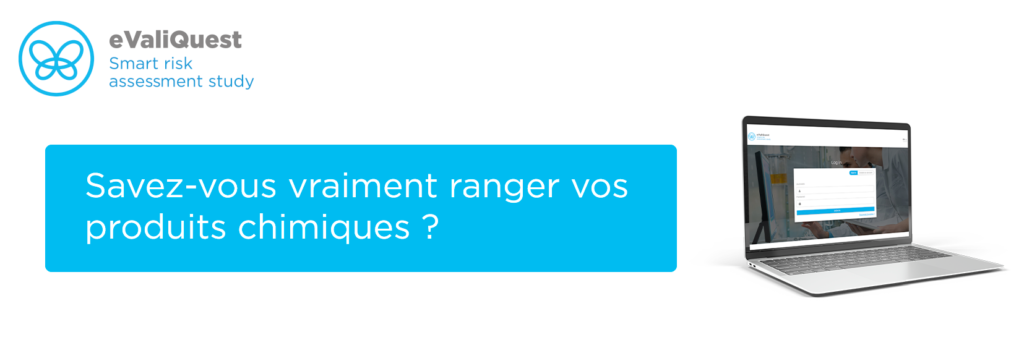 ActusEnvironnement
ActusEnvironnement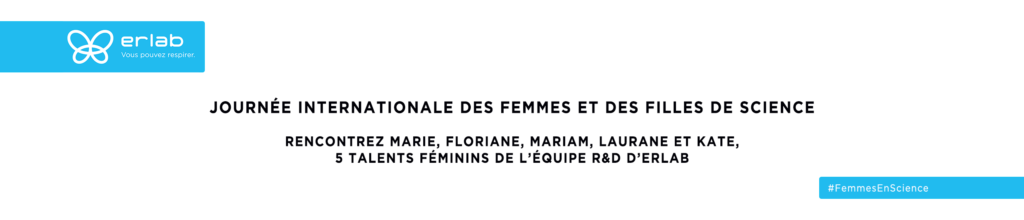 ActusEnvironnement
ActusEnvironnement ActusEnvironnement
ActusEnvironnement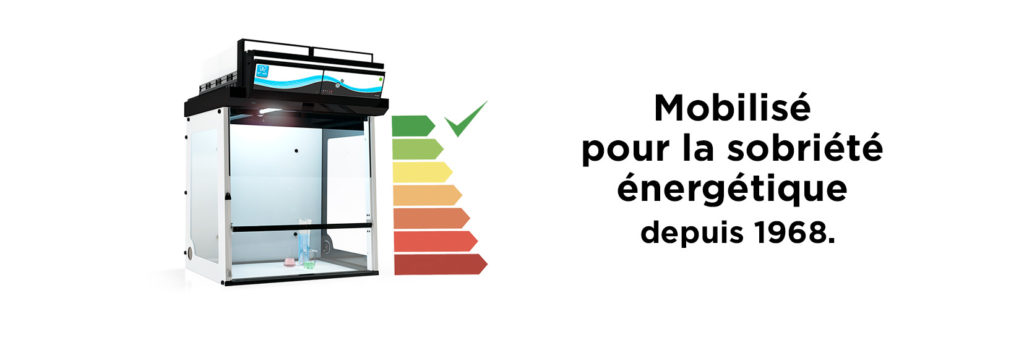 ActusEnvironnement
ActusEnvironnement ActusLaboratoire
ActusLaboratoire ActusPollution de l'air
ActusPollution de l'air ActusLaboratoireSanté
ActusLaboratoireSanté
© Erlab Conçu et réalisé par Pixels Ingénierie


